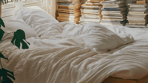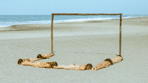S2 Ep 6 : les vacances des autres
Il y a ceux qui vivent avec, et ceux qui subissent à cause d’elles. Les vacances scolaires : ce calendrier parallèle qui régit nos vies, nos prix, nos humeurs, même quand on n’a jamais touché un cartable.


Musique de fond : Forever young, Bob Dylan
Lundi, les bambins reprenaient le chemin de l’école et animaient mes journées de télétravail à nouveau - puisque mon bureau au troisième étage donne sur une cour d’école. J’ai regardé ces petits humains courir, se retrouver, jouer au chat et même se taper dessus. J’ai ensuite téléphoné à mon amie, en pleine forme, les yeux rivés sur ce spectacle d’insouciance et de marelle que je ne pouvais m’empêcher de jalouser.
Ciao les kids
« Putain, sayez, mes vacances commencent » me lâche-t-elle alors qu’elle gère une équipe de 50 personnes à l’international de son domicile 60 heures par semaine. « On dej? Italien et verre de rouge ? » ajoute ma bonne vieille patte qui confond lundi midi et vendredi soir. Agrippée à ma gourde d’eau de coco mélangée à du miel, du sel et du citron pour soigner mes péchés du weekend, je lui réponds avec douceur que je suis plus motivée à l’idée de cuisiner les os de mon ex pour en faire un bouillon blindé en collagène que de me taper un verre de pif à 12:00.
Las(t) Ketchup et pommes de terre smiley
D’un côté, les parents : épuisés, stratèges, pros du Tetris émotionnel. Ils jonglent entre centre aéré, grands-parents disponibles deux jours sur quinze, nounou introuvable et patron moyennement compréhensif. Ils rêvent de repos, finissent au Club Med et se battent pour un transat à 8h avant de refuser la chorégraphie piscine à midi. Le baby-club devient leur seul espoir de silence. Le soir, ils boivent un Spritz tiède devant le buffet à thème, mi-coupables, mi-soulagés, en se promettant qu’un jour, le temps d’un weekend - ils partiront sans les enfants pour une fois. Ils se souviennent de leurs belles années, l’époque où le smiley était un cachet pour ne pas se coucher, à l’inverse d’un pyjama kiabi trop court qui les obligerait à rester à la maison une veille de 11 novembre.
Aux chiottes l’UCPA
En face, il y a les autres. Ceux qui n’ont que leur teckel nain, leurs plantes aromatique qui ne font que crever ou leurs deadlines pros/persos à charge. Oui, ceux qui paient malgré tout le prix fort. Billets d’avion inabordables, hôtels complets, plages bondées et jacuzzi-urinoir. Ce sentiment d’être toujours hors tempo : trop tôt pour partir, trop tard pour réserver. Ils déposent une demande de congé en juin, reçoivent un “non, trop de parents absents” et finissent par rester coincés au bureau, clim défaillante et Instagram stories débordant de weekends au Touquet-Paris-Plage et club Mickey. Quand ils parlent de prendre congé en plein mois de novembre, les autres répondent « tu t’en vas en stage de kite surf au Maroc faire des rencontres ? » ou « tu as la belle vie toi » - oubliant que leur message d’absence à la con type « petit break familial à la famille » redirige toutes les six semaines des personnes mal baisés vers nos boîtes mails et lignes personnelles.
Pause (cantine)
Les cris de la cour d’école me rappellent que ça recommence, toujours. Les enfants s’amusent d’un terrain de macadam et de craie, et les adultes s’envoient des salades dégueulasses devant l’écran le midi quand ils ne courent pas pour une conduite au hockey le mercredi. Et quelque part entre les deux, on essaie tous de réapprendre à respirer. En partageant une crêpe au coin de la rue avec une amie qui ne vit pas du tout le même quotidien que le nôtre, ou dans une activité sportive qui nous rappelle qu’on peut oublier son téléphone dans le vestiaire.
La vie sans hors-saison
Peut-être que les vacances, les vraies, ne sont pas dans le calendrier scolaire mais dans ce moment suspendu où l’on cesse de courir. Seul, accompagné ou en famille. Où tout redevient simple, léger, vivant.
Comme une marelle, un jour d’été, avant qu’on oublie comment jouer ou un jour de carnaval, quand totalement déconcentrée je rêve de ce costume d’astronaute très bien porté.
P.A (Plaisirs assumés) : Un weekend à Londres, et une nouvelle paire de botte chez Sézane.