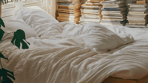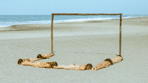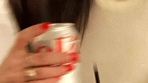S2 Ep 2 : le beauf de quelqu'un
À trente ans, on reconnaît un vin nature à l’étiquette mais on grimace encore devant une playlist trop premier degré. Juger est un sport national, que j'ai moi-même pratiqué sans m'en rendre compte.


Thirties
4 min ⋅ 22/09/2025
Musique de fond : Respect, Aretha Franklin
Il y a plus de dix ans, je suis cheffe de rubrique dans un magazine féminin à Paris. J’écris des articles de mode pour les femmes, et pour tous ceux qui veulent les lire. Reporter de guerre, certes, mais uniquement celle des chiffons : ma seule bataille reste de péter les scores d’audience en veillant la nuit pour commenter les robes des Oscars. Le journalisme que je pratique est passionnant, prenant mais je ne sauve aucune vie. J’analyse, je commente et je critique la tendance, les tenues et trop souvent l’esthétique.
Investie dans mon boulot et dans mes relations de bureau, j’écris comme une fusée et me spécialise dans l’art du pute-à-clic. C’est ainsi que je plaide ma cause pour assister aux défilés et je suis capable de jeûner pour m’offrir un sac Stella McCartney. Quand je ne marche pas du pied droit dans la merde sur le chemin de mon premier cocktail Tiffany sur les Champs-Élysées, je tanne ma rédactrice en chef pour décrocher des interviews. Elle sait.
Exercice que certaines détestent, mais qui m’amuse, me fait voyager, me donne l’impression de cocher les cases. Avoir des souvenirs à raconter, envoyer à ma tendre grand-mère des clichés qu’elle pourra fièrement imprimer. Une jeune femme qu’il faut clairement remettre à sa place, si vous voulez mon avis, car si je suis née avec la mâchoire bien marquée, c’est ma tête qui grossit à vue d’oeil.
J’y arrive
J’ai toujours eu de la chance : bien élevée, bien nourrie, bien voyagé. Convaincue de n’avoir aucun accent du Nord (où j’ai grandi), je me répète que ma fibre pacifiste m’excuse de toute moquerie. Quand on me demande d’où je viens, je réponds que je suis née à Paris, sans préciser que j’ai quitté la capitale avant la maternelle. J’ai peur de prononcer les lettres de la ville de mon enfance, de chopper l’étiquette de provinciale, de cute et que l’on me reprenne quand je prononce les “a” et les “o”. Quelle idiote.
2014, me voilà face à Isabelle Nanty, à l’interroger sur une comédie française où s’agite une famille attachante et un peu loufoque. J’ose demander si jouer un personnage aussi caricatural ne risque pas de vexer, ou de donner à une communauté l’impression d’être “beauf”. La connerie du mot lâché trop vite. Elle a compris ce que je voulais dire avec maladresse et impudeur. J’attaque directement ceux qui s’emparent d’un vilain “heinnnn” toutes les treize secondes (ce que je fais également sans m’en rendre compte, pour précision). Ces familles sympas de mon patelin qui rêvent d’un camping près de Monaco, d’un deuxième flamby au dessert et d’un tour en Lambo le jour de leur anniv. J’ai honte, je deviens rouge tomate car elle met le doigt sur un réel problème : je vais à l’encontre de tout ce qu’on m’a enseigné.
« Et vous, vous êtes aussi une beauf. Pour quelqu’un, en tout cas. » La phrase tombe, nette, comme un rappel à l’ordre. Je suis choquée, je rentre chez moi remontée et je prends le temps d’y réfléchir quelques années plus tard - quand ma fame à trois balles prend un coup et que j’approche la trentaine. Plus mature, je crois au karma et à la bienveillance que je me promets de pratiquer.
Margaux Tuche
La réflexion me consume, je réalise que ce n’est pas anodin. Le rejet est une réalité : c’est en jugeant les pratiques de certains que l’on se place aussi dans une case dé-sappréciée par d’autres. Comme l’écrit Rose Lamy dans Ascendant beauf, le mot dit plus qu’il n’y paraît : derrière nos snobismes culturels, tels que moquer une passion pour Johnny, une nappe cirée à un mariage, lever les yeux au ciel devant Hanouna ou rire d’un passionné de ski de fond, se cachent des jugements de classe. Et ces jugements bougent avec nous, des deux côtés.
L’anecdote, au fait, histoire qu’on soit tous un peu beauf - mais moins con ce soir. Le mot “Beauf” date des années 70, quand Cabu a décidé de s’inspirer de son propre beau-frère pour en faire un portrait - soit ce personnage franchouillard, râleur, pastis à la main et idées courtes en bandoulière pour la presse.
Beauf, mais pas frère
La triste nouvelle, c’est que le monde fait bien les choses et que le challenge peut parfois s’inverser au cours d’une vie. On peut grimper l’échelle sociale et regarder son passé de biais ; redescendre et devenir la cible du mépris qu’on exerçait hier. Le mot “beauf”, c’est un peu un boomerang qui revient quand nos certitudes s’effritent. Comme quand j’ai peur d’admettre ma passion pour les voitures qui vont vite, ou pour les comédies musicales dont j’achète les tickets. Le Roi Soleil, ça marche à nouveau by the way - si l’envie de m’accompagner vous prenait.
Ce qui me frappe, et ça a bien évidemment déjà été mon cas, c’est à quel point le “beauf” est toujours l’autre : celui qu’on définit pour mieux s’en distinguer. On trace des frontières invisibles, on se protège derrière nos codes, l’éducation que l’on veut se donner, notre routine faussée (le citron pur du matin et les squats qu’on ne fait jamais), nos playlists et nos adresses préférées. Le truc ? Ces frontières ne tiennent jamais très longtemps : il suffit d’un déménagement, d’un changement de situation financière pour que nos repères vacillent et que l’on se retrouve, malgré soi, du côté que l’on jugeait hier. Je suis une bonne chti républicaine à Paris, un cliché français au rouge à lèvre pacifiste aux Etats-Unis et une Parisienne coco dans la ville où j’avais grandi.
Be cool, baby
Le cool, ce n’est pas une posture figée : c’est une circulation. Ce qui est irrésistible à Belleville paraît anecdotique à Neuilly, ce qui passe crème à Bruxelles semble “too much” à Lille. Et alors ? C’est justement cette variété qui fait sa richesse. Le cool, ce n’est pas d’écraser les goûts des autres, mais plutôt de les accueillir - ou du moins de ne pas les commenter. D’accepter qu’une trentenaire avec un tshirt Bruce Springsteen puisse être tendre ici, ironique là-bas, et sincèrement rock-iconique ailleurs.
Parce qu’au fond, le cool, c’est la curiosité, la transmission et l’envie de partager. C’est ce qui nous relie autour d’un refrain au karaoké ou d’une table qui dure un peu trop tard. Une langue mouvante qui change selon la ville, la bande ou l’époque, mais qui garde le même socle : faire sentir aux autres qu’ils appartiennent, qu’ils ont leur place, leur futur et leur passé. Au plus simple, sans ruminer.
Alors oui, je suis forcément la beauf de quelqu’un. Hier, aujourd’hui, demain. Et c’est peut-être la seule vraie boussole : choisir l’humilité plutôt que le mépris, la sympathie plutôt que le snobisme. Parce qu’entre juger et danser, j’aimerais en ce qui me concerne toujours choisir la piste.
P.A (Plaisirs assumés) : un restau bonne franquette, des amis au franc-parler et pas de prise de tête s’il-vous-plaît